Claude, Georges, PICARD, Un piton séparé du reste du monde, préface de Jean-Charles Jauffret, Editions du Net, décembre 2013, 230 p.
Si les soldats appelés en Algérie sont souvent restés silencieux, des témoignages ont paru peu à peu. Et, comme pour les poilus de 1914-1918, leur examen montre que l’épreuve commune prit des aspects fort divers selon les cas individuels. Sur un rayon qui s’enrichit, le journal de Claude Georges Picard fournit son apport propre et mérite l’attention de l’historien, comme le souligne Jean-Charles Jauffret dans sa préface.
Quand il est incorporé, l’auteur, fils de médecin, vient de quitter l’Université, où son cursus n’était pas éclatant. S’il possède un esprit critique aiguisé, il s’est soumis à l’appel des armes qui lui était imposé : « J’ai choisi par lâcheté d’être otage ». Il observe les autres d’un œil méfiant et il s’observe lui-même sans complaisance. Il scrute volontiers la complexité de ses sentiments, avec une abondance de références littéraires, à Camus bien sûr, et aussi à Rimbaud, à Céline et à Saint-Exupéry. Il a refusé d’être officier, mais il s’est vu nommer caporal, ce qui le distingue déjà parmi ses camarades, ses « codétenus », dit-il. On retrouve chez lui le double décalage de la culture et du grade, qu’a finalement analysé Nicolas Mariot pour les intellectuels mobilisés de la Grande Guerre, dans son dernier opus, Tous unis dans la tranchée ? A fortiori, la communication est à peu près nulle avec les quelques appelés FNSA (Français de souche nord-africaine) de sa section, comme avec les supplétifs harkis qui s’y sont joints.
Il est affecté sur un piton de la montagne kabyle, à près de 1 200 mètres d’altitude. Son poste de chasseurs alpins doit surveiller une forêt dense, où se cachent les maquisards de l’ALN, et le village limitrophe, qui est classé officiellement comme « non rallié ». Par l’opération Jumelles du plan Challe, « la rébellion » vient d’y subir des pertes sérieuses, mais elle n’a pas été annihilée complètement et elle bénéficie de la complicité de la population. Donc, « la zone n’est pas sûre » et « les accrochages » à coups de feu sont fréquents quoique brefs.
Claude, Georges, Picard doit d’abord se comporter en combattant. Armé d’un fusil mitrailleur, il participe à des embuscades nocturnes, aussi longues que vaines. Il assiste, révolté silencieusement, à des interrogatoires brutaux, marqués de recours à la torture, et à une exécution sommaire, maquillée pour la forme. Cependant, sa générosité le pousse en même temps à ouvrir une école pour les enfants du village. Les femmes et les vieillards lui font bon accueil et son chef de poste le laisse faire, « en pensant pouvoir en tirer profit ». Cet adjudant-chef, Roumain passé par la Légion étrangère, baroudeur professionnel, ne manque pas de finesse. L’auteur ouvre aussi un dispensaire, avec des médicaments collectés en métropole, et il écrit les réponses aux lettres qu’envoient les villageois travailleurs en métropole. Cette action lui vaut les compliments du colonel, du préfet et même du général en chef, qui passent en inspection. Lui-même souffre de cette « vie de schizophrène écartelée entre le poste et le village » (p. 116). Et il y revient souvent : « même si je joue malgré moi plusieurs rôles contradictoires au 11/39, je les joue et je l’accepte » (p. 89) ; « entre le soldat de nuit qui n’hésiterait pas à tirer et le gentil Français qui soigne, apprend à lire et à compter je m’y perds » (p. 93).
Une donnée capitale est, que dans ce secteur homogène, il n’y a aucune population de souche européenne. De ce milieu différent, l’auteur ne rencontre, lors de brefs déplacement, qu’un maire d’esprit plutôt ouvert, et une serveuse aux réactions haineuses. Ici l’affrontement colonial de deux camps est exceptionnellement simple. On n’y perçoit nullement le problème considérable que pose la présence en Algérie d’une communauté européenne, nombreuse dans la plaine côtière et implantée depuis plusieurs générations. La métropole s’est sentie solidaire de compatriotes qui avaient naguère versé leur sang pour sa libération et c’est pourquoi le cruel conflit algérien se prolongea si longtemps. Mais sur un « piton séparé du reste du monde, on peut faire abstraction de cette composante capitale de la tragédie algérienne.
Dans le temps, ce séjour s’écoule de janvier 1961 à février 1962. Après six années de guerre, les occupants du poste partagent la lassitude générale de l’opinion : « Continuerons-nous longtemps à combattre, à souffrir, à mourir pour une cause inexistante ? » (p. 129). Sans pour autant approuver l’action du réseau Jeanson, que « j’essaie en vain de comprendre » (p. 148). Sur leur poste transistor, les occupants du piton suivent en spectateurs lointains les premières négociations avec le FLN, le putsch des généraux, l’intervention du général de Gaulle. Localement, le climat politique se détériore et le nouveau chef de poste, un jeune sergent engagé, au tempérament répressif, manifeste de la malveillance envers Picard. Celui-ci aspire à « la quille » (la fin du service), qui intervient avant les semaines sanglantes du printemps 1962. En partant, il s’interroge : « Qu’ai-je fait ? Un peu la guerre, beaucoup la paix, ou l’inverse » (p. 202).
En 1975, l’auteur aura la curiosité de revenir en visite au village de ces années difficiles. Il y sera chaleureusement reçu par ses anciens élèves, par leurs familles et même par quelques-uns des hommes qui l’ont combattu. Certains sont au travail dans la région parisienne et « aujourd’hui ces anciens fellagha sont venus de France en vacances dans leur village ». Il s’en sentira réconforté.
Pierre Barral

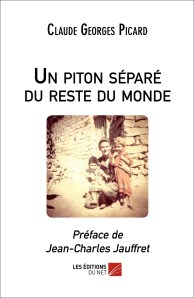
Laisser un commentaire