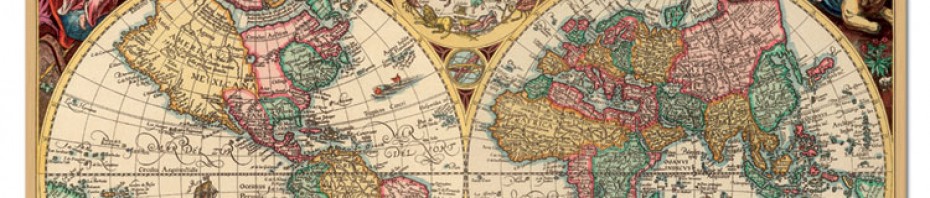Dès lors qu’on évoque les sociétés militaires privées (SMP), une des premières questions qui se pose est celle de leur qualification. C’est une question fondamentale et il est impossible de trouver de la littérature sur le sujet qui ne prenne position. Beaucoup qualifient abusivement les SMP de mercenaires ; certains éludent la question en affirmant qu’elles opèrent dans un vide juridique ; d’autres, plus au fait de la science juridique, perçoivent leurs employés – quand ces sociétés sont employées par des États – comme des civils suivant les forces armées, voire dans certaines situations comme des membres des forces armées irrégulières.
La question de la qualification est intéressante pour le juriste en raison de la complexité de l’exercice. Les SMP désignent en effet un panel de sociétés et de fonctions très diverses. Si les SMP sont souvent associées dans l’imaginaire collectif à des mercenaires, elles offrent un panel de services bien plus large que les seules fonctions de combats qui ne représentent finalement que la portion congrue des activités des SMP. Il est vrai que le domaine d’intervention des SMP est très étendu puisqu’il couvre pour l’essentiel des missions de soutien, d’appui et de logistique. Ce que Peter W. Singer nomme « les firmes militaires de soutien » par opposition aux firmes militaires prestataires qui sont employées pour des activités plus militaires dans son sens belliciste et qui peuvent les amener à conduire ou participer aux hostilités ; et aux firmes militaires de consultation, composées de conseillers en matière de défense et de sécurité ainsi que d’instructeurs1. À tire d’exemple il est possible de regarder la situation en Irak en mars 2011 : le « base support » autrement dit l’entretien des bases, la gestion de la restauration et de l’habillement représentait 61% du total des agents des SMP, quand la sécurité ne représentait que 18% des effectifs2. Mais derrière cet aspect purement juridique – presque technique – de la qualification stricto sensu, une autre question se pose, celle des enjeux de cette qualification.
Au-delà des SMP, de manière générale, la qualification juridique va entrainer des conséquences importantes, notamment dans la détermination de statuts et de régimes applicables. En l’espèce, la qualification juridique d’une SMP ou de ses employés permettra

de définir leurs droits, leurs obligations et leurs responsabilités, ainsi que ceux qui incombent à l’État qui les emploie ou duquel elles ont la nationalité.
La question de la qualification ne se limite pas à une seule discipline juridique ; elle concerne un ensemble de de branches du droit qui peuvent connaitre des mêmes qualifications ou au contraire diverger. La qualification juridique se fait dans chaque discipline en fonction des définitions et des éléments propres à celle-ci. Néanmoins, ces différentes matières ne doivent pas être perçues comme cloisonnées entre elles car la qualification dans l’une d’elle peut influencer les autres. On le constate à travers les définitions utilisées dans ces différentes matières. Ainsi la Convention de New York de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires3, comme la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine de 1977 sur l’élimination du mercenariat en Afrique4 reprend – exception faite d’un alinéa sur la participation directe aux hostilités – la définition du mercenaire en droit humanitaire5. Par ailleurs l’étude de jurisprudences de Cours statuant dans des domaines différents permet également d’observer cette influence. A titre d’exemple la Cour internationale de Justice, statuant sur l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, vise les conclusions «hautement convaincantes » du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie6.
La qualification retenue en droit humanitaire par exemple ne va pas se limiter à cette discipline et pourra s’étendre au droit pénal ou au droit de la responsabilité. Mais il est important de garder à l’esprit que si une branche du droit peut influencer une autre, elles restent distinctes et sont parfois hermétiques, proposant leur propre définition. Prenons la définition du mercenaire : cette dernière est très restrictive en droit humanitaire puisqu’elle énonce six critères cumulatifs dont certains, comme le fait de prendre part aux hostilités « en vue d’obtenir un avantage personnel », sont pour le moins subjectif. Le professeur Éric David, spécialiste du droit humanitaire et de la question du mercenariat et du volontariat international, écrit d’ailleurs à propos de ces critères que « les conditions requises pour qu’un combattant apparaisse comme mercenaire sont tellement restrictives qu’il faudrait être

suicidaire pour réussir à les remplir »7 ; cette volonté de réduire au minimum la définition s’explique par la ratio legis du droit humanitaire. Ce dernier a en effet pour vocation de régir les conflits armés et d’offrir une protection juridique aux acteurs de ces conflits. Or, les mercenaires représentent la seule catégorie juridique à être privée de protection en droit humanitaire. Afin que la qualification de mercenaire ne puisse être entendue trop largement – ce qui aurait pu exclure un nombre important de personnes de la protection du droit humanitaire – sa définition a été voulue la plus limitée possible. En revanche en droit pénal, le droit n’a pas cette vocation humaniste ; il n’a pas pour but de préserver les personnes des souffrances inutiles de la guerre mais pour réprimer une activité considérée comme répréhensible. Sa définition a donc pour objectif de comprendre l’ensemble des activités qui doivent être sanctionnées. Si la Convention des Nation unies de 1989 et celle de l’OUA de 1977 ont repris la définition du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, elles l’ont également étendue à des activités plus larges que des activités armées. La Convention de l’OUA inclut les activités de financement dans la définition du mercenariat, et ces deux conventions ont étendu la définition à des situations qui se situent hors du champ de compétence ratione materiae du droit humanitaire car en dehors d’un conflit armé comme « les actes de violences concertés visant à renverser un gouvernement ».
De même, malgré des renvois réciproques entre la CIJ et le TPIY, on note des divergences d’interprétation dans leurs jurisprudences. La plus connue de ces oppositions est sans doute celle portant sur la qualification de conflit armé international de la guerre de Bosnie. En partant des mêmes faits et de la même notion de contrôle, les deux juridictions sont parvenues à des conclusions différentes : le Tribunal a qualifié la situation de conflit armé international en développant l’idée d’un contrôle global de la Serbie sur les milices serbes de Bosnie alors que la Cour a, quant à elle, préféré le concept d’un contrôle effectif, plus restreignant, et a qualifié le conflit de non international. Cette divergence peut s’expliquer par les différences qui existent entre les juridictions. Pour le TPIY qui statue en matière pénale, qualifier un groupe armé d’organe d’un État lui permet de qualifier le conflit d’international et donc d’étendre sa compétence à un plus grand nombre d’infractions. En revanche, la CIJ met en jeu la responsabilité des États – États qui consentent librement à sa juridiction – et la qualification des groupes armés va donc déterminer si l’État est responsable des comportements de ces groupes, ce qui en plus de la réparation d’un éventuel dommage va emporter d’importantes répercussions diplomatiques.

À travers ces clivages, on voit apparaitre les enjeux que porte la question de la qualification. Sans entrer dans les détails de la qualification, il est nécessaire de présenter rapidement les conséquences importantes que peut entrainer la qualification des SMP.
Le premier cas concerne le droit humanitaire. S’il n’est pas le plus important en termes géopolitique et de relations internationales, il l’est par sa nature et par le nombre de personnes qu’il va concerner. Le droit humanitaire distingue entre deux grandes catégories d’acteurs dans les conflits, les combattants qui ont le droit de prendre part aux hostilités et qui peuvent être visés par les attaques et les civils qui a contrario sont exclus des hostilités et qui doivent être épargnés autant que faire se peut par les parties aux conflits. Il existe bien évidemment dans chacune de ces catégories des sous-divisions mais qui pour le moment ne demandent pas que l’on s’y attarde. Si les employés des SMP sont considérés comme des civils, ce qui est le cas dans la plupart des cas situations si l’on en croit les commentaires du CICR sur le document de Montreux8, alors ils n’ont pas le droit de participer directement aux hostilités. Cela signifie qu’ils ne bénéficient pas du privilège du combattant qui l’exonère de répondre de sa responsabilité tant pénale que civile pour les faits qu’ils ont mené dans la conduite des hostilités. En l’absence de ce privilège, les civils qui participent aux hostilités – et donc les SMP le cas échéant – peuvent être poursuivis pour les infractions qu’ils ont pu commettre (meurtre, homicide involontaire, destruction de biens…) et peuvent être amenés à réparer les dommages et préjudices causés.
À côté de cette responsabilité des personnes physiques se pose également la question de la responsabilité de la SMP en tant que personne morale. Si les premières peuvent bénéficier d’une immunité judiciaire, les secondes ne le peuvent en aucun cas. En l’état actuel des choses il n’existe pas de juridiction internationale compétente pour juger les personnes morales. Cependant cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas être sanctionnées en raison de violation du droit international par une Cour nationale, soit en raison de l’effet direct de la norme, soit par la voie d’une transposition en droit interne. La France, en matière de crime de mercenariat sanctionne non seulement les mercenaires mais également toutes les personnes qui entrainent ou permettent les activités de mercenariat. La Convention de New York de 1989 relative au mercenariat n’a pas été signée et ratifiée par la France, ainsi la question de son application directe ne se pose pas. Néanmoins la loi 14 avril

2003 relative à la répression de l’activité de mercenaire9, introduisant et pénalisant le crime de mercenariat en droit français est pour le moins inspirée de la Convention de New York. Sans qu’il s’agisse réellement d’une transposition, on peut y voir l’exemple d’une norme internationale appliquée par le truchement d’une norme nationale dans l’ordre interne.
Enfin la qualification de la SMP va lui prêter un lien plus ou moins étroit avec l’État qui l’emploi. L’imputabilité du fait d’un agent d’une SMP à l’État va dépendre pour l’essentiel de la qualification de ce personnel. Si la SMP est considérée comme appartenant aux forces armées, ou si elle agit sous le contrôle ou en suivant les directives et instructions de l’État, elle pourra être associée à un organe de facto de l’État10 et en tant que tel les actions de ce dernier pourront engager la responsabilité de l’État. L’État est responsable de ses propres actions et omissions, mais il l’est aussi pour les violations de ses subdivisions et de ses organes qui en tant que représentants de l’État vont engager sa responsabilité. Si la SMP est un organe de l’État ce dernier sera donc responsable, y compris en cas d’action ultra vires de la SMP ou de ses membres. L’État pourrait être alors amené à réparer les préjudices causés par la SMP agissant pour son compte, y compris si cette dernière outrepasse les attributions qui lui ont été fixées dans le cadre de sa mission, « toute autre solution permettrait aux Etats d’échapper à leur responsabilité internationale en choisissant d’agir par le
truchement de personnes ou d’entités dont l’autonomie à leur égard serait une pure fiction »11.
Cependant cela ne doit pas faire oublier qu’en dehors de toute question de qualification, l’État qui emploie une SMP est débiteur d’obligations. Il découle notamment de l’article 1er commun aux Conventions de Genève et de l’article 1 paragraphe 1 du Premier protocole additionnel que l’État a l’obligation de respecter le droit humanitaire. La même obligation existe en matière de Droit international des droits de l’Homme dans les préambules des deux Pactes de 1966. Le Comité International de la Croix-Rouge – initiateur et gardien des Conventions de Genève – voit dans le devoir de l’État de respecter les conventions celui de « les faire respecter par ses autorités civiles et militaires, les membres de ses forces armées et, de façon générale, l’ensemble de la population »12. Cette obligation de faire respecter les

conventions ratifiées par l’État n’est pas spécifique aux droits humains, elle trouve son fondement dans le principe général du pacta sunt servanda13, c’est-à-dire l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi. Il incombe ainsi à l’État de veiller au respect de ses obligations internationales par les SMP qu’il emploie. Cette obligation prend notamment la forme d’un devoir de due diligence « afin de prévenir et, le cas échéant, réprimer les actes des entreprises privées ou de leurs employés qui attentent aux droits humains »14.
Enfin la qualification des SMP peut également influer sur la qualification de la nature d’un conflit et donc sur le droit applicable dans celui-ci. Dans la mesure où une SMP est constituée en un groupe armé organisé, la question qui se pose sur la nature du conflit est la même que celle qui se posait au TPIY et la CPI sur les milices serbes durant la guerre de Bosnie. Certains États utilisent en effet des SMP afin d’intervenir de manière indirecte dans un conflit généralement interne. La question s’est déjà posée en Bosnie ou au Sierra Leone. Si une SMP peut être assimilée à un organe de facto de l’État ou si elle agit sous sa conduite alors le conflit qui était jusque-là non international devient international avec une extension importante des règles applicables, mais surtout l’État viole le principe de non-recours à la force et de non-ingérence de la Charte des Nation unies avec toutes les
incidences diplomatiques qu’une telle violation peut engendrer.
sécurité privées et le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2006, vol. 88, p.202. Sans reconnaitre que cette obligation s’applique à toute la population, l’auteur affirme « Ces personnes peuvent de toute évidence inclure aussi les employés des SMP/SSP engagées par un État qui ne sont pas membres de ses forces armées ».
1 SINGER Paul W.,Corporate Warriors, 2003, in DUFORT Philippe, Typologies des acteurs de l’industrie des services militaires, Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité Université du Québec à Montréal, Octobre 2007, p.15-16
2 Moshe Schwartz, Joyprada Swain, Congressional Research Service, Department of Defense Contractors inAfghanistan and Iraq: Background and Analysis, R40764, p. 15-17
3 article 1, paragraphe 1, Convention de New York de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires
4 article 1, paragraphe 1, Convention de l’Organisation de l’Union Africaine de 1977 sur l’élimination du mercenariat en Afrique
5 article 47 du protocole 1 aux conventions de Genève
6 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p.134, §223
7 DAVID Éric, principes de droits des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 4ème éd., 2008, p494
8 CICR, Le document de Montreux, Commentaires explicatifs, p.36
9 Article 436-1 du code pénal
10 Article 8 du projet d’article de la commission du droit international
11 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, op. cit, p.205, par.392 12 SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe, ZIMMERMANN Bruno, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève : CICR, Martinus Nijhoff, 1986, p.35, par.41. et GILLARD Emanuela-Chiara, « Quand l’entreprise s’en va-t-en guerre : les sociétés militaires et sociétés de sécurité privées et le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2006, vol. 88, p.202. Sans reconnaitre que cette obligation s’applique à toute la population, l’auteur affirme « Ces personnes peuvent de toute évidence inclure aussi les employés des SMP/SSP engagées par un État qui ne sont pas membres de ses forces armées ».
13 SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe, ZIMMERMANN Bruno, op cit, p.36, par.42.
14 COTTIER Michael, « Attribution de mandats aux entreprises de sécurité et militaire privées et régulation de leurs activités : éléments à considérer », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2006, vol. 88, p.228.
Thibaut Lanteri, étudiant du Master Histoire Militaire, Géostratégie, Défense et Sécurité (promotion 2014-2015)